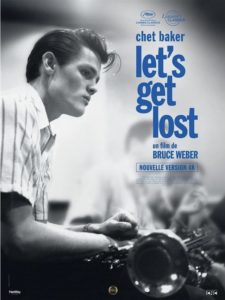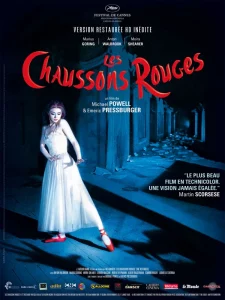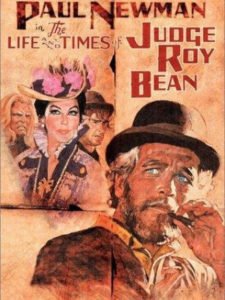21 octobre 2024

Photo : SensCritique
Pourrait-on citer le titre de la pièce de Pirandello « Six personnages en quête d’auteur » pour caractériser Tant qu’il y aura des hommes de Fred Zinnemann ? En effet, nous avons bien ici six personnages mais qui cherchent leur auteur pourrait-on dire.
Cela se passe dans une base militaire américaine à Hawaï à la veille de l’attaque de Pearl Harbor. Le jeune soldat Prewitt (Montgomery Clift) est affecté à la base dirigée par le capitaine Holmes (Philip Ober) et l’adjudant Warden (Burt Lancaster). Il se lie d’amitié avec Maggio (Frank Sinatra), un joyeux luron, provocateur et grande gueule. Prewitt est un ancien boxeur qui a eu la malchance de rendre aveugle l’ami avec lequel il s’entraînait. Le sachant boxeur émérite, le capitaine lui propose de faire partie de l’équipe de boxe de la base et l’incite à combattre pour la gloire du régiment. Mais Prewitt refuse obstinément, fidèle à son voeu de ne plus jamais boxer. On le provoque, il esquive les coups, et finit cependant par mettre KO son adversaire, sous le regard satisfait du capitaine. Prewitt est un homme de principes et de convictions. Il ne supporte pas les injustices et les brimades des autres soldats. Il refuse de s’excuser, lorsque, exécutant les peines qui lui sont infligées, un gradé lui fait un croche-pied ou renverse un seau d’eau sur le sol qu’il était en train de nettoyer. Il s’oppose ainsi à l’institution militaire, à l’obéissance et à la discipline exigées d’un soldat. Sous ses dehors de héros contestataire, Prewitt est un homme fragile, vivant les injustices comme une souffrance. C’est lorsqu’il joue du clairon que le spectateur ressentira cette souffrance. À un moment il se saisit du clairon et joue, dans un bar, devant ses camarades dans une attitude tendue, exprimant force et souffrance à la fois. Mais c’est évidemment dans l’une des scènes cultes du film que ses sentiments s’expriment le mieux. Son ami Maggio qui le soutient dans son refus des injustices, s’échappe de la base alors qu’il était de garde. La sanction ne se fait pas attendre. Il est envoyé chez le chef de la police militaire, le sergent James « Fatso » Rudson (Ernest Borgnine, fascinant), sadique et tortionnaire et accessoirement pianiste du bar. Fatso n’attendait que cela, car peu avant Maggio s’était moqué de lui en le traitant de mauvais pianiste. Soumis à des brimades et à des tortures, Maggio, s’enfuit, blessé et meurt dans les bras de Prewitt et Warden.
Il faut dire que le film de Fred Zinnemann ne raconte aucune histoire. C’est plus un succession de scènes sur la vie quotidienne d’un régiment dans une base juste avant que n’éclate la deuxième guerre moniale. Au-delà, c’est un regard critique de la caméra sur l’institution militaire qui ne manque pas de condamner les effets délétères voire mortifères de l’armée sur la vie des soldats. On a vu comment Prewitt était humilié; comment Maggio, torturé par la police militaire, expire près de son ami. Au milieu du camp, le soir, Prewitt se saisit de son clairon et interprète la sonnerie aux morts pour son ami Maggio. Quelle tension, quelle émotion, quelle fragilité et quelle souffrance envahissent Prewitt, le visage débordant de larmes. Toute la base écoute, plongée dans un silence poignant. A moitié éclairé par la lueur de la lune, l’adjudant Warden lui aussi écoute. Sur son visage, on devine l’expression d’un sentiment de sympathie pour Prewitt, voire même, d’affection. Par cette scène et quelques autres, Fred Zinnemann veut prouver que les « hommes de guerre » – du moins certains de son film – ne sont pas des brutes et que derrière leur apparente virilité, la sensibilité aux autres, les sentiments humains sont inscrits dans leur nature.
Tous les personnages principaux du film évoluent dans des chassés-croisés qui structurent le récit. Dans la plupart des séquences ils avancent par paire, forment des duos pourrait-on dire. Prewitt et Maggio, liés par l’amitié et le soutien mutuel. Prewitt ira d’ailleurs venger son ami en tuant le sadique Fatso, formant un duo maléfique celui-là. Prewitt et Warden, respectueux l’un vers l’autre et unis dans des sentiments de sympathie, malgré des pointes de dérision et d’ironie émaillant leur relation. On peut revoir à ce propos – encore une scène culte – Warden et Prewitt, complètement ivres, assis au bord d’une route, ressasser leur solitude et leurs tourments, là où justement Maggio venait mourir.
Deux femmes viennent compléter le tableau : Karen (Deborah Kerr), la femme du capitaine et Lorene (Donna Reed) la compagne de Prewitt. Le cinéaste ne leur accorde pas un rôle majeur, mais leur présence dans le film enrichit l’humanité des personnages. Ainsi en est-il des couples Prewitt/Lorene et Warden/Karen. Karen et Warden tissent une relation adultérine dont la rencontre des corps, baignés par les vagues, d’une sensualité torride, atteste l’impossibilité de leur amour. C’est là encore la scène culte que le monde entier aura admirée. Avec Lorene, c’est la raison qui l’emporte dans son amour pour Prewitt. Alors que celui-ci, blessé, déserte après avoir tué Fatso, il n’a qu’une seule idée, rejoindre ses compagnons de combat lors de l’attaque de Pearl Harbor. Lorene le supplie de rester et cherche à le convaincre de retourner aux Etats-Unis où ils pourront se marier et avoir une vie rangée. Mais Prewitt meurt, tué accidentellement par ses camarades. La dernière séquence d’une immense mélancolie, laisse voir les deux femmes côte-à-côte sur un bateau retournant aux USA, le regard perdu sur les colliers de fleurs jetés dans la mer.
Classique jusqu’au bout de la pellicule, le film est traversé par les préoccupations qui doivent certainement tenailler Fred Zinnemann : la justice, le courage, le respect de la dignité humaine… mais aussi le pouvoir démesuré et mortifère de l’armée. Des personnages émouvants et d’une grande sensibilité dans un grand film humaniste et universel.
Tant qu’il y aura des hommes
Fred Zinnemann
USA – 1953
Avec Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Philip Ober
Disponible en DVD et Blu-ray
==================================================